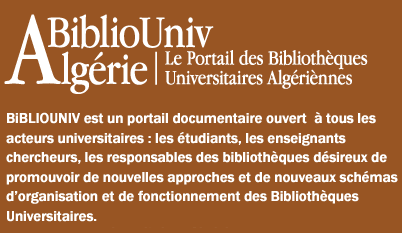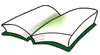A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |

 Nouveauté
Nouveauté
| Titre : | Étude de la comorbidité : Trouble du Spectre Autistique et Epilepsie, à propos d’une enquête prospective à l’EHS Ain Abessa, Sétif |
| Auteurs : | Djamila BOUDELLIOU, Auteur ; Abdelkrim MESSAOUDI, Directeur de thèse |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : Université Sétif 1 Ferhat Abass, 2025 |
| Format : | 494 p. / ill. / 30 x 21 cm |
| Accompagnement : | CD. |
| Langues: | Français |
| Résumé : |
-Cette étude prospective explore la comorbidité entre le trouble du spectre autistique (TSA) et l’épilepsie en Algérie, dans un contexte marqué par des disparités d’accès aux soins et une sous-représentation dans la recherche. Les objectifs sont : (1) déterminer la prévalence de la comorbidité TSA-épilepsie, (2) identifier les facteurs cliniques et contextuels associés, et
(3) proposer un protocole adapté aux spécificités du système de santé local. Introduction Cette étude prospective examine la comorbidité entre le trouble du spectre autistique (TSA) et l’épilepsie en Algérie, un contexte caractérisé par des inégalités d’accès aux soins et une sous-représentation dans la recherche. Les objectifs sont : (1) estimer la prévalence de la comorbidité TSA-épilepsie, (2) identifier les facteurs cliniques et contextuels associés, et (3) proposer un protocole adapté aux particularités du système de santé local. Méthodes Sur une période de 12 mois, 129 enfants et adolescents atteints de TSA (âgés de 2 à 17 ans) ont été recrutés à l’EHS Ain Abessa (Sétif). Une régression logistique binaire avec régularisation LASSO (AUC = 0,9) et des tests statistiques exacts (test de Fisher, méthode de Clopper-Pearson) ont été utilisés pour évaluer les associations. Les données cliniques (sévérité du TSA, paternes de crises), les facteurs développementaux (retards, régression) et les éléments contextuels (accessibilité aux soins) ont été systématiquement collectés et analysés. Résultats Cette étude prospective observationnelle de 12 mois, menée à l’EHS Ain Abessa (Sétif, Algérie) sur 129 enfants et adolescents atteints de TSA, apporte une contribution significative aux neurosciences cliniques en identifiant un phénotype algérien distinct et en proposant un protocole standardisé et personnalisé pour la comorbidité TSA-épilepsie. L’étude met également en lumière des résultats inattendus influencés par des facteurs contextuels prédominants. Le phénotype identifié, avec une prévalence de 45 % (58/129, IC 95 % : 36,2– 53,9 %, χ² = 38,2, p < 0,001), est fortement associé à des formes sévères de TSA (OR = 2,8, IC 95 % : 2,0–4,1, p < 0,001, Tableau P80) et à un ensemble de prédicteurs cliniques robustes : épilepsie à début précoce non contrôlée, affectant principalement les enfants de 2 à 5 ans (OR = 4,5, IC 95 % : 3,10–6,7, p < 0,001, Tableau P81) ; épilepsie sévère caractérisée par des crises quotidiennes (OR = 5,1, IC 95 % : 3,4–7,6, p < 0,001, Tableau P81) ; prévalence significativement plus élevée de retard global de langage dans le groupe comorbide (OR = 5,9, IC 95 % : 2,5–13,6, p < 0,001, Tableau P46) ; régression développementale principalement observée dans les cas de TSA avec épilepsie (OR = 3,8, IC 95 % : 2,7–5,5, p < 0,001, Tableau P81) ; taux significativement plus élevés de retard psychomoteur (OR = 2,8, IC 95 % : 1,4–5,9, p = 0,004, Tableau P40) ; et déficit intellectuel sévère/profond, exclusivement retrouvé dans le groupe comorbide (OR = 6,5, IC 95 % : 0,80–54,3, p = 0,06, Tableau P41). Ce profil, modulé par des dynamiques liées à l’âge (épilepsie sévère passant de 71 % à 0 % entre 2–5 ans et 13–17 ans, χ² = 38,2, p < 0,001, Tableau P30), reflète une vulnérabilité neurodéveloppementale unique, exacerbée par des facteurs contextuels majeurs. Ces derniers incluent un retard diagnostique moyen de 3,2 ans (OR = 1,8, IC 95 % : 1,2–2,6, p = 0,01, Tableau P81), la consanguinité comme facteur culturellement pertinent mais statistiquement limité (OR = 1, IC 95 % : 0,5–2,2, p = 0,8, Tableau P81 Bis), et une disparité rurale-urbaine marquée, les cas comorbides étant surreprésentés en milieu rural (56,9 %, p = 0,06, Tableau P14) par rapport à une prédominance des cas de TSA seul en milieu urbain (59,2 %, Tableau P14). De plus, cette étude propose un protocole standardisé adapté au contexte, dans un cadre de médecine de précision, incluant : un dépistage précoce systématique avant 3 ans, ciblant la régression développementale et les retards de langage par des EEG systématiques (100 % des cas TSA + épilepsie, p < 0,001, Tableau P53) et des outils d’évaluation validés (CARS, PedsQL) ; un accès prioritaire à l’IRM pour les cas à haut risque, comme les TSA sévères avec régression (54,9 %, p < 0,001, Tableau P53) ; une approche multidisciplinaire intégrant neurologues, orthophonistes et éducateurs spécialisés ; et des stratégies de traitement optimisées utilisant des antiépileptiques modernes subventionnés (par exemple, lacosamide). Le protocole inclut également des unités EEG mobiles en zones rurales pour pallier le manque d’accès aux infrastructures de santé, notamment l’IRM, indisponible dans près de la moitié des cas (54,9 %, p < 0,001, Tableau P53). Plusieurs résultats inattendus émergent : l’absence d’association significative avec le TDAH, contrairement aux attentes basées sur la littérature antérieure, possiblement masquée par la sévérité des comorbidités ou l’utilisation d’outils diagnostiques localement inadaptés (p = 0,1, Tableau P51) ; une prévalence accrue parmi les individus de milieux socio-économiques plus élevés, reflétant potentiellement un biais d’accès diagnostique (OR = 3,8, IC 95 % : 1,2–11,3, p = 0,03, Tableau P14) ; et un effet protecteur associé à l’éducation maternelle (OR = 0,2, IC 95 % : 0,1–0,6, p = 0,01, Tableau P14), contrasté par un risque accru lié à l’éducation paternelle (OR = 2,2, IC 95 % : 1–4,8, p = 0,008, Tableau P14), soulignant les influences socioculturelles sur l’accès aux soins. Discussion Ces résultats révèlent un phénotype algérien distinct, caractérisé par une prévalence élevée de la comorbidité TSA-épilepsie et une vulnérabilité neurodéveloppementale exacerbée par des facteurs contextuels tels que les retards diagnostiques et les disparités rurales-urbaines. L’absence inattendue d’association avec le TDAH pourrait refléter des biais diagnostiques locaux. Un protocole standardisé, incluant un dépistage EEG systématique etune approche multidisciplinaire, est proposé, malgré certaines limites, notamment un biais de sélection et des données transversales. Une étude nationale est recommandée pour valider ces résultats et adapter les interventions au contexte socioculturel et économique de l’Algérie. Cette étude identifie un phénotype algérien unique marqué par une épilepsie pharmacorésistante à début précoce et des atteintes neurodéveloppementales sévères, amplifiées par des barrières systémiques telles que l’accès restreint à l’IRM et la ruralité. Les résultats valident les hypothèses H1–H5, mettant en évidence le rôle critique des marqueurs cliniques (régression, anomalies EEG) comme indicateurs précoces de vulnérabilité. Comparée à la littérature internationale, la prévalence élevée rapportée dans cette étude reflète probablement à la fois une stratégie de détection proactive et un biais hospitalier favorisant les cas complexes. Les recommandations de l’étude incluent : • Dépistage EEG systématique dès l’âge de 2 ans, avec accès prioritaire à l’IRM pour les cas de TSA sévères. • Un protocole standardisé intégrant des unités EEG mobiles et des subventions pour des antiépileptiques modernes. • Études multicentriques pour valider ces résultats et explorer davantage les interactions gène-environnement. Conclusion En enrichissant les modèles neurodéveloppementaux, cette étude souligne la nécessité d’une approche de médecine de précision adaptée aux contextes locaux. Elle plaide pour une vigilance clinique accrue, un accès équitable aux outils diagnostiques et la mise en œuvre d’une stratégie de soins multidisciplinaire. Bien que les limites de l’étude (taille de l’échantillon, biais de sélection) n’affectent pas la validité de ses associations, elles mettent en évidence l’urgence de renforcer les infrastructures de santé et les programmes de formation professionnelle en Algérie pour améliorer le dépistage précoce et l’intervention pour la comorbidité TSA-épilepsie. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| TH/00168/25 | TH/00168 | Thèse | Salle des périodiques | Thèses de doctorat | Exclu du prêt |