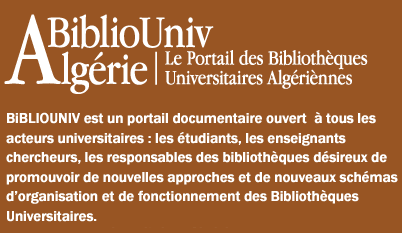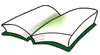|
Résumé :
|
-Les infections sexuellement transmissibles (IST), causées par Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG), Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH) et Ureaplasma urealyticum (UU), sont fréquemment observées, en particulier dans les pays voisins de l’Algérie. Cependant, l’absence de données récentes sur leur prévalence dans le pays est préoccupante. Ce manque de données résulte en grande partie d’une prise en charge basée principalement sur une approche syndromique, sans diagnostic étiologique systématique. Ces infections entraînent de graves complications pour la santé des femmes, comme des inflammations pelviennes, l'infertilité, ainsi que des risques accrus pour la santé maternelle et fœtale, notamment la prématurité, un faible poids à la naissance et des infections néonatales. Il devient donc urgent de mener des études sur la prévalence et les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de ces IST en Algérie pour mieux gérer ces infections et renforcer les stratégies de prévention. L’objectif de cette étude était d’estimer le taux de prévalence des infections à CT, NG, TV, MH et UUchez les patientes consultantes pour une infection génitale dans la commune de Batna. Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive transversale auprès des patientes âgées de 18 ans et plus, en activité génitale, résidant dans la commune de Batna, ayant consulté entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022, pour infection génitale. Pour chaque patiente, une fiche de renseignements sur les données sociodémographiques et les facteurs de risques a été remplie. Toutes les femmes ont bénéficié d’un examen clinique et d’un prélèvement endocervical avec recherche microbiologiques des cinq pathogènes. La détection de CT a été faite par méthode Immuno-chromatographique ; examen direct et culture pour la recherche de NG ; examen direct à l’état frais et coloration au MGG pour TV ; et la culture sur milieu liquide pour les mycoplasmes urogénitaux (MH, UU). Résultats : Nous avons inclus 648 femmes symptomatiques, dont 218 ont été infectées par au moins une des IST étudiées avec une prévalence globale de 33.6% (218/648), la moyenne d’âge était de 32,67+/-6,025 [18 ; 54]. Les prévalences de chacun des germes étudiés étaient : CT (16,2%), NG (0,3%), TV (6,3%), MH (5,4%) et UU (18,5%). Les infections mono-microbiennes étaient majoritaires, avec prédominance d’UU (76 cas), suivi de CT (51 cas), MH (8 cas) et TV (3 cas). NG n’était isolé qu’en co infection chez deux patientes. La co-infection CT+TV représentait 16,1 % des IST et 43,75 % des co-infections, suivie de MH+UU à 10,6 % et de CT+UU à 7,3 %. Les facteurs de risque retrouvés chez les patientes infectées étaient : La situation matrimoniale (P=0.01), La grossesse actuelle (P=0,04), Les antécédents d’avortement (P=0,02), Le nombre de partenaire dans les 12 derniers mois (P<1‰), Les antécédents d’infection génitale (P<1‰), Le statut vis-à-vis du VIH (P=0.039). D’autres facteurs de risque liés au(x) partenaire(s) ont été identifiées dont : Le nombre de partenaires du conjoint/partenaire de la femme (P<1‰), Les antécédents d’infection génitale chez le conjoint/partenaire (P<1‰), Le partenaire actuellement symptomatique (P=0.03). Les aspects cliniques retrouvés étaient l’aspect et la couleur jaunâtre des leucorrhées (P=0.004), la cervicite (P<1‰), l’endocol
saignant (P<1‰), le prurit vaginal était plus fréquent chez les femmes non infectées par les IST (P=0,002). Notre étude a analysé en détail les facteurs de risque et les particularités cliniques de chaque pathogène. Elle a également exploré la perception du risque, révélant un niveau de méconnaissance préoccupant au sein de la population. Conclusion : L’épidémiologie nationale des IST reste largement méconnue, plusieurs axes d’amélioration peuvent être envisagés. Des données plus représentatives sont urgentes, l’adoption du dépistage ciblé sans méconnaitre les formes asymptomatiques souvent négligées et la sensibilisation restent les principaux leviers de la lutte contre la propagation des IST et du VIH.
|

 Nouveauté
Nouveauté